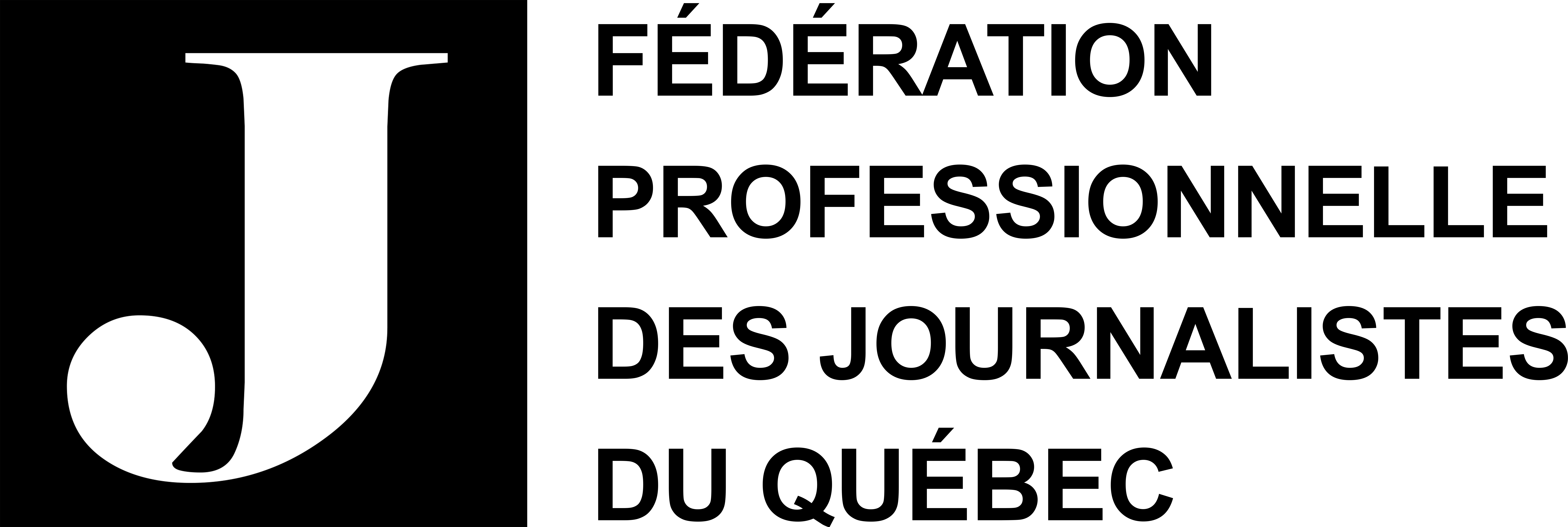Par Hugo Meunier
Les journalistes font une job importante dans le contexte actuel. On l’a répété ad nauseam et tout le monde s’entend là-dessus. Un service essentiel même, consacré par le premier ministre François Legault, dont la popularité rendrait jaloux n’importe quel chef d’État despotique.
Les journalistes font une job importante dans un contexte extrêmement difficile. Les compressions allaient bon train avant la pandémie, alors on peut pardonner l’enflure verbale du président de notre fédération qui a récemment utilisé le terme « hécatombe » pour traduire l’effondrement des revenus publicitaires, qui ont entraîné une saignée dans pratiquement toutes les salles de rédaction de la province.
Quelque 143 employés chez Groupe Capitales Médias, 130 chez Cogeco, 10 % des effectifs chez Québecor, réductions salariales de 10 % à La Presse etc etc.
URBANIA – où je travaille – n’y échappe pas, avec plusieurs coupures aussi.
Bref, les médias étaient déjà au tapis après l’exode des revenus publicitaires vers l’Eldorado des GAFAM, personne n’avait besoin d’une crise sur le sundae.
Les journalistes font une job importante, disais-je, avec les moyens du bord et en tirant ingénieusement profit des moyens technologiques mis à leur disposition.
Comme l’écrivait ici avec justesse la collègue Isabelle Paré dans son dernier billet, nous avons rapidement réinventé nos façons de faire, transposant nos entrevues, réunions et points de presse sur Skype, Zoom et autres outils, en plus de ressusciter à toutes les sauces le défunt Facebook live, qu’on avait enterré quelque part en 2017.
Là où je suis moins d’accord avec ma consœur et où je viens casser le party (virtuel), c’est lorsqu’elle affirme que c’est contre nature de se réinventer ainsi, nous qui « sommes rompus aux contacts humains et dont l’essence consiste à embrasser de nos yeux le monde qui nous entoure. »
C’est vrai que c’est contre nature, sauf que ça fait déjà un bail que le journalisme de confinement est à la mode, loin de ces contacts humains censés constituer le Saint-Graal de notre quête d’information.
Ça fait un moment déjà que les outils technologiques nous ont rendus plus sédentaires et moins enclins à sortir, à l’heure où tant d’informations se trouvent au bout de notre clavier.
Dans ce contexte d’opinions pondues à la va-vite, d’entrevues téléphoniques, d’enfilages de directs et d’explainers devant des écrans verts, les chances de contracter le coronavirus – ou même la grippe saisonnière – m’apparaissent moins grandes que celles de pogner une tendinite loin d’un bureau ergonomique.
Oui, c’est joli de publier sur les réseaux sociaux des photos de nos installations de fortune et de nos visages rieurs en train de flatter un chat ou siroter un café dalgona lors d’une réunion sur Zoom, mais je redoute qu’à terme, ce buzz exacerbe davantage cette tendance au confinement et n’éloigne encore un peu plus le journaliste du terrain, sa véritable place.
Ça fait presque 20 ans (déjà crisse) que je gagne ma vie dans les médias et j’ai toujours trouvé que le journalisme de terrain était l’enfant pauvre de la profession, snobé par les puristes et non reconnu à sa juste valeur.
À mon sens, ce contact direct avec les gens pour qui on prétend écrire est crucial et hélas déjà souvent relégué au deuxième plan, au profit d’un coup de fil ou de l’avis d’un expert.
Plusieurs ne seront pas d’accord avec moi, fair enough.
N’empêche qu’il faut être un amateur de déni pour ne pas reconnaître une profonde distorsion entre les médias et la population au cours des dernières années. Pour ceux qui en doutent, je vous rappelle « Donald Trump » et « la CAQ majoritaire », deux événements qui ont pris les médias par surprise, reflétant « dedans ta face » le clivage vertigineux entre nous, les journalistes, et le proverbial « vrai monde »
Tout ça pour dire que ça me préoccupe lorsque j’entends des journalistes se draper dans le quatrième pouvoir et se vanter d’être capable de maintenir le droit du public à l’information en mou dans leur sofa, entre une séance de yoga en ligne, une livraison de vin nature et un épisode de Tiger King.
On a la pandémie bourgeoise, à notre image — ou celle de notre fil FB, mais ça c’est une autre histoire.
Ce qu’il faut retenir, en gros, c’est que je nous trouve assez frileux.
Je m’explique mal pourquoi il y a si peu de journalistes présentement sur le terrain, pourquoi on ne va pas plus à la rencontre de ces milliers de concitoyens qui maintiennent la province sur le respirateur artificiel, pourquoi on n’a pas la décence de sortir de notre confort pour les rencontrer à deux mètres de distance et non au téléphone.
Ne serait-ce que pour mieux raconter, décrire, pourquoi ne pas aller voir en personne la commis du Jean Coutu, le livreur à vélo du dépanneur du coin, les anges gardiens du milieu hospitalier et les autres employés des services essentiels. Ils n’ont pas peur, ou un peu, peut-être, alors pourquoi nous, journalistes, refusons d’aller les voir dans leur élément ?
Plusieurs journalistes le font déjà et ce billet vise justement à leur lever mon chapeau. Le récent reportage de Rad sur les héros de l’ombre, les photographes de La Presse et d’ailleurs qui documentent fabuleusement la crise, les assidus des points de presse de la triade Legault-Arruda-McCann, les collègues de la télé aussi, toujours au front, sans oublier les nombreux reportages terrain de ma jeune collègue Jasmine pour URBANIA.
Bref, plus que jamais j’ai l’impression que c’est le moment de prouver notre rigueur et de prouver qu’on est prêt à s’exposer aux mêmes risques qu’une préposée aux bénéficiaires, surtout qu’on gagne au moins deux fois plus d’argent qu’elle, pour la majorité d’entre nous.
Je ne suis pas meilleur que personne (bon, quand même un peu) parce que je préconise le terrain, loin de là. Je sais bien que ma visite gonzo dans un Costco ou ma rencontre avec des snowbirds confinés dans un terrain de camping d’Hemmingford n’accotent pas des dossiers fouillés, portraits et scoops ni ne me vaudront une nomination au prix Judith-Jasmin. C’est seulement qu’il se passe enfin quelque chose de plus palpitant que la saga du coton ouaté de Catherine Dorion. Et si la job de Carey Price est d’arrêter des rondelles (dans la mesure du possible), la mienne est de raconter des histoires. Sur le terrain idéalement.
Enfin, j’imagine que tout le monde a ses raisons. Bon ok, ma blonde garde le fort (comme d’habitude) et mes enfants passent tellement de temps sur des écrans qu’ils n’ont peut-être même pas entendu parler du coronavirus. Je suis donc très chanceux, j’en suis conscient. Possible que plusieurs ont des jeunes enfants, des casse-têtes logistiques, des conjoints inquiets, ce n’est pas à moi de juger et je m’en excuse si ce billet enfle cette perception.
Je discutais récemment de tout ça avec une amie qui a couvert plusieurs guerres. Comme moi, elle relevait la frilosité ambiante. « Un masque dans le visage, c’est moins lourd qu’une veste pare-balle », m’a-t-elle dit. Belle image.
Parce que les morts ont beau continuer à s’empiler au Québec, je persiste à trouver inconcevable que les journalistes prennent moins de risques que la caissière du Maxi ou même Infoman.
J’ai peur qu’après la crise, les médias décident pour toutes sortes de raisons (espace, économie, réduction des transports, fluidité, rapidité etc.) de maintenir cette façon de livrer l’information. Chouette, on est capable de faire rouler un média à distance avec des effectifs réduits sans mettre le nez dehors et en attirant plus de lecteurs que jamais.
C’est à mon sens ça, le vrai danger qui nous guette après la crise.
-30-
Diplômé en littérature, Hugo Meunier s’est tourné vers le journalisme pour payer son loyer. Après avoir couvert les conflits au Liban et en Afghanistan, il s’est découvert une passion pour le journalisme d’immersion.
Il a été journaliste à La Presse, puis Directeur de la production de contenus numériques au Journal de Montréal. Il est maintenant journaliste à Urbania.
Les propos reproduits ici n’engagent que l’auteur. La FPJQ ne cautionne ni ne condamne ce qui est écrit dans ces textes d’opinion.


.jpg)