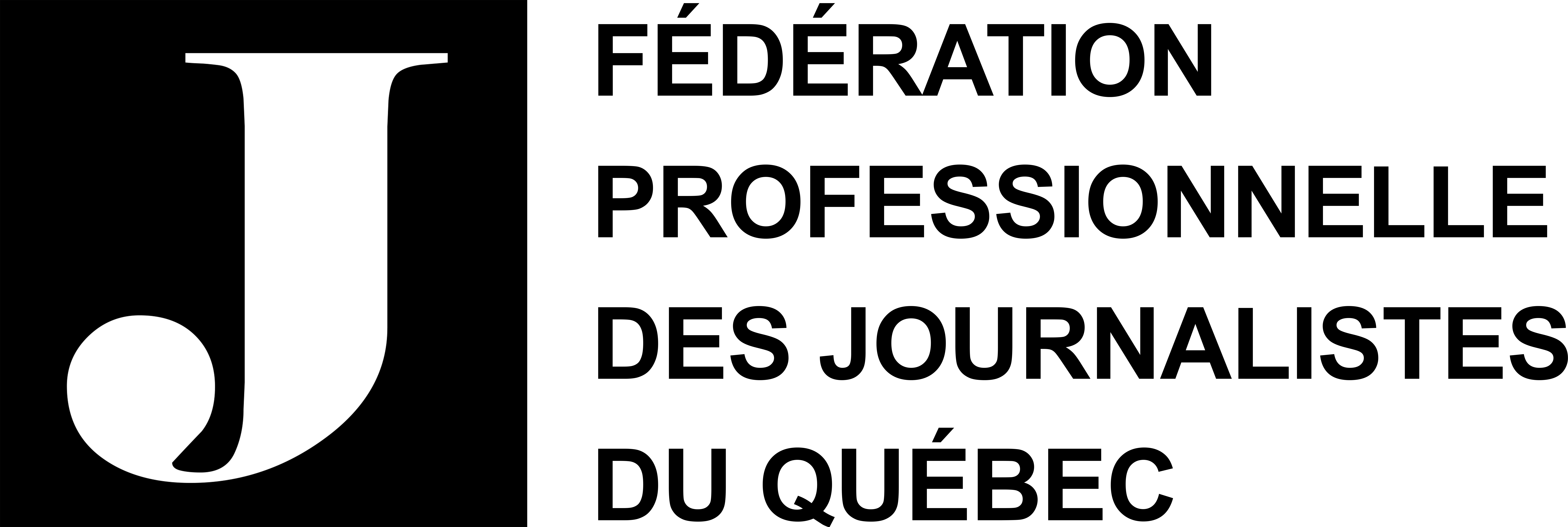Par Marie-Ève Martel, journaliste à La Voix de l'Est et vice-présidente de la FPJQ
Cette chronique est parue initialement dans La Voix de l'Est
Quand j’étais plus jeune, je croyais que le métier le plus dangereux était celui de commis dans un dépanneur.
Une connaissance qui a exercé ce métier il y a longtemps a été victime d’un vol à main armée, tenue en joue par un homme armé. Elle s’en est remise, mais cet incident continue parfois de la hanter.
Toujours est-il qu’en choisissant de vivre de mes passions, l’écriture et la communication, jamais je n’aurais pensé qu’un jour, j’en viendrais à craindre pour ma sécurité ou celle de mes collègues. Pour moi, le journalisme est le plus beau métier du monde : j’ai donc du mal à accepter le fait qu’aux yeux d’autres personnes, il soit laid, voire honni.
Peut-être avez-vous appris récemment que des stations de télévision, et pas les moindres, ont décidé de retirer le lettrage de leurs véhicules pour éviter à leurs employés d’être pris pour cible par des individus convaincus que les médias d’information sont des « vendus » ou des « collabos ».
Peut-être vous souvenez-vous qu’à Chicoutimi et à Sherbrooke, des voitures de la station TVA ont été incendiées ou vandalisées par des idiots qui contestaient la couverture médiatique du réseau.
Peut-être avez-vous vu à la télévision certains journalistes tenter de rapporter des événements en direct tout en se faisant importuner par des imbéciles qui les invectivaient ou qui croyaient pouvoir faire tout ce qu’ils voulaient devant la caméra, faisant fi de tout savoir-vivre. Pensez juste à Kariane Bourrassa, cette journaliste qui s’était fait «enlacer» par deux inconnus en plein tournage lors d’une manifestation.
Peut-être vous souvenez-vous aussi de cette journaliste qui s’est fait lancer une bouteille de bière par la tête? Ou bien de ce journaliste physiquement agressé par un homme dont il couvrait le procès pour pédophilie?
Ce n’est pas normal.
Pas pour rien que de plus en plus de médias paient des agents de sécurité pour accompagner leurs journalistes lors d’événements où des débordements sont prévisibles.
Les journalistes, parce que leur travail est public et s’effectue en public, sont des cibles parfaites pour quiconque souhaite se défouler. Comme nous sommes les messagers de l’actualité, il est plus souvent facile de s’en prendre à nous.
Mais nous ne sommes pas simplement payés pour «écrire» ou «parler devant une caméra». Notre rôle est d’aller au fond des choses, d’analyser la nouvelle, de donner la parole à toutes les parties impliquées.
Chaque texte que je publie est accompagné de mon nom, de ma photo et de mon adresse courriel. C’est donc très facile de me rejoindre – en un ou deux clics — pour réagir, à chaud, aux contenus que je produis.
Récemment, un moron m’a contactée pour m’invectiver. Selon lui, parce que j’avais mis la photo d’une femme en détresse pour illustrer un dossier sur la prévention du suicide, j’incitais les hommes à commettre l’irréparable, eux qui sont trois fois plus susceptibles de passer à l’acte.
Faut le faire! Surtout que tous les intervenants interrogés dans le cadre du reportage étaient des hommes dont la photo était aussi publiée.
J’avoue lui avoir répondu en des mots très polis sans toutefois m’empêcher de lui souhaiter un bon transit intestinal. En réponse, il m’a promis « un chien de sa chienne » en croyant me faire peur.
Finalement, à part l’ignorer, il n’y avait rien à faire.
Il m’est déjà arrivé de communiquer avec la police après avoir reçu des insultes et des menaces par courriel ou via Facebook. On avait alors refusé de prendre ma plainte –— pourtant mon droit à titre de citoyenne — en me disant de me faire une carapace et qu’eux-mêmes, policiers, étaient la cible de missives vicieuses et qu’il fallait apprendre à vivre avec.
Une autre fois, et auprès d’un autre corps policier, j’ai dénoncé la pratique du doxing dont j’ai été la cible. Le doxing, c’est quand quelqu’un publie des informations personnelles de quelqu’un, comme une adresse ou un numéro de téléphone, dans l’espoir que leurs abonnés aillent embêter cette personne.
Même si on m’avait avertie qu’on tentait ainsi de « me détruire », ma plainte n’a pas mené à une enquête, car cette promesse de destruction massive aurait pu concerner ma réputation, m’a-t-on dit, ce qui relèverait alors du droit civil et non du criminel.
Une de mes collègues en Outaouais a eu davantage de bol, elle qui a été prise au sérieux quand un lecteur enragé lui a proposé d’aller « s’asseoir sur les rails et d’attendre le train ».
On a tendance à parler de cas isolés quand ce type d’incident survient. Comme si ça n’arrivait que de temps en temps.
Ce n’est plus le cas.
Une tendance lourde
Un sondage mené par la firme Ipsos, dont les résultats ont été dévoilés plus tôt cet hiver, nous apprend que 72% des répondants, tous des journalistes professionnels, ont subi du harcèlement au cours de la dernière année, deux fois sur trois via les réseaux sociaux ou par courriel. Dix pour cent des journalistes ont été menacés de mort dans le cadre de leur travail au courant des 12 derniers mois.
Pire, 38% des répondants ont déclaré avoir été harcelés en personne, et 10% ont été agressés physiquement, toujours dans la dernière année.
Et même si 84% des journalistes ayant pris part à l’enquête sont d’avis que le phénomène ne va pas en s’améliorant, bien au contraire, à peine quatre sur dix osent le dénoncer.
Vous me direz que les auteurs de ces menaces ne sont qu’une minorité. Et vous avez probablement raison ; le plus récent sondage Léger sur le degré de confiance accordée par la population à différents corps de métier octroie une note de 54% aux journalistes. Ce faisant, la profession se situe au 42e rang sur une liste non exhaustive de 50 métiers.
Néanmoins, quand on sait que les actes de violence à l’endroit des journalistes sont en hausse, on n’a d’autre choix que de réaliser que ceux qui se méfient de nous hésitent de moins en moins à passer à l’action.
C’est ça qui fait peur.
Nous sommes au Québec, au Canada. Pas en Arabie Saoudite, en Iran ou en Chine, où les journalistes sont emprisonnés, battus, voire abattus parce que leur travail dérange.
Le Canada ne devrait même pas être sur le radar de Reporters sans Frontières.
-30-


.jpg)