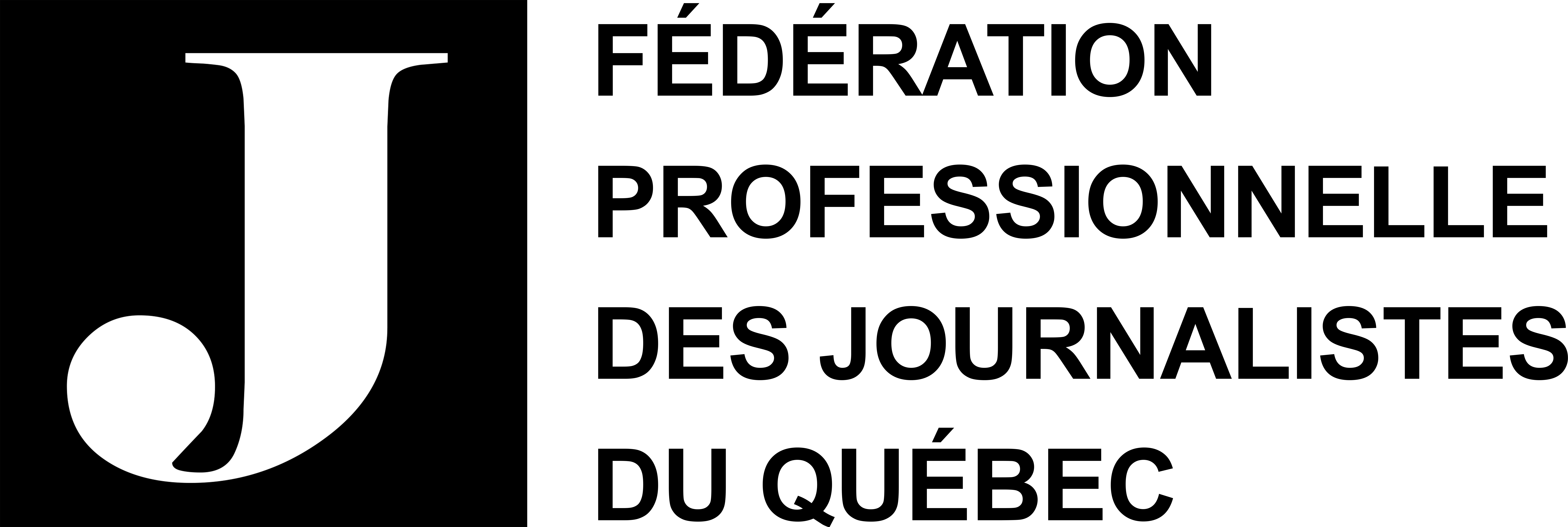Par Valérie Borde, chef de bureau Science et santé, L’actualité, Jean-François Cliche, journaliste scientifique, Le Soleil, Marine Corniou, journaliste scientifique, Québec Science et Marie Lambert-Chan, rédactrice en chef, Québec Science
Dans l’essai « Covid-19, nos angles morts », publié dans le dernier numéro du Trente, Pierre Sormany reproche aux journalistes d’avoir endossé la cause de la santé publique depuis le début de la pandémie et d’avoir trop agi comme simple courroie de transmission des spécialistes.
S’il loue le travail des journalistes scientifiques, plus spécifiquement, il affirme du même souffle que ces derniers auraient agi davantage comme vulgarisateurs que comme chiens de garde. Ce n’est pas du tout notre perception.
Il y a assurément un bilan à faire de la couverture médiatique de la crise sanitaire, et des leçons à en tirer. Celle qui nous semble la plus évidente, pour l’instant, est que les journalistes scientifiques ne sont pas assez nombreux au Québec pour pouvoir répondre à la demande dans de telles circonstances, où il faut tout à la fois expliquer et rapporter la science et ses controverses, surveiller et questionner le bien-fondé des décisions des autorités, contrer la désinformation et mener des enquêtes fouillées pour creuser certaines questions.
Dans un contexte où les ressources humaines et matérielles sont limitées (et où, faut-il le rappeler, nous avons été nombreux à devoir conjuguer la conciliation télétravail-famille, en plus de subir des réductions d’horaire ou de salaire), il est certain que nous avons dû faire des choix. Mais ceux-ci nous ont été dictés par ce qui nous a semblé prioritaire pour l’intérêt public et non par les autorités de santé publique.
Autre leçon : il faut améliorer la capacité des journalistes généralistes à couvrir ces questions, pour leur éviter notamment les pièges du recours aveugle à des experts ou à des résultats provenant d’études de piètre qualité. Avons-nous, dans cette situation de crise, assez misé sur le travail d’équipe entre journalistes scientifiques et généralistes ? Aurions-nous pu demander à ce que des journalistes scientifiques assistent au point de presse quotidien ? Qu’aurions-nous pu mieux faire ? Voilà des questions légitimes.
Ce bilan, par contre, ne doit pas être fait en regardant la science et les décisions d’hier avec les yeux d’aujourd’hui. M. Sormany semble être tombé dans ce piège quand il indique que les premières études sur les aérosols émis par des porteurs du virus auraient dû nous pousser immédiatement à conclure à la prédominance de ce mode de transmission et à dénoncer l’attitude des autorités dans le dossier de la ventilation. Or, à ce moment, la science était très confuse : les quelques études qui pointaient vers ce phénomène ne fournissaient pas de résultats incontestables, et entraient en contradiction avec ce que les chercheurs pensaient avoir compris jusque-là de la transmission par aérosols dans les années passées.
Cependant, dès l’été 2020, plusieurs journalistes ont explicitement évoqué la question de la ventilation, et expliqué le débat – qui a duré pendant des mois – au sein de la communauté de recherche. M. Sormany escamote pourtant cette importante discussion pour ne retenir que les résultats les plus hâtifs qui plaidaient pour une transmission par aérosols. Rappelons que les cas de superpropagation qui, aux yeux des uns, prouvaient clairement la transmission par aérosols étaient considérés comme très flous par beaucoup d’autres experts — il s’agissait souvent de transmission dans des espaces clos et entre personnes qui étaient à moins de 1 mètre les unes des autres, et où la contagion par gouttelettes demeurait possible. La définition « classique » des aérosols, qui excluait tout ce qui avait un diamètre supérieur à 5 microns (alors qu’il s’agit en fait d’un continuum), a elle aussi brouillé le portrait pendant longtemps.
Il est très facile, maintenant que la propagation par aérosols ne fait plus de doute, de regarder tout cela avec nos yeux et nos connaissances de 2021, et de trancher que les journalistes n’ont pas bien fait leur travail. Mais leur tâche, alors, était de rendre compte du débat qui avait lieu en 2020, pas de le trancher à la place des vrais experts.
De la même manière, M. Sormany accuse les journalistes d’avoir accepté sans broncher l’imposition de mesures sanitaires inutiles pour les gens qui se rencontraient à l’extérieur, au printemps 2021. Encore ici, il ignore les analyses critiques que certains d’entre nous avons fait de ces mesures — de même que la véritable levée de boucliers qu’elles avaient provoquée, mais passons. Remontons encore plus loin dans le temps : nous n’avons pas hésité à dénoncer très rapidement (dès le 24 mars 2020) l’hystérie autour du risque de contamination par les surfaces. Mais selon M. Sormany, il aura fallu « plus d’un an avant que les journalistes ne remettent en question notre obsession du lavage des mains et des surfaces ».
M. Sormany reproche enfin à la presse scientifique d’avoir « fermé le dossier » trop vite dans le cas de l’hydroxychloroquine (HCQ), cet antipaludique que le médecin français Didier Raoult a promu comme une pilule miracle pour soigner la COVID-19. Mais c’est un point qui nous semble plutôt étrange dans un tel plaidoyer. L’HCQ a été testée et retestée à toutes les étapes possibles des soins, de la prophylaxie jusqu’au traitement des patients hospitalisés, et elle n’a jamais montré d’effets bénéfiques — pas dans les études bien menées, en tout cas.
M. Sormany est bien forcé de l’admettre mais, selon lui, les journalistes scientifiques auraient quand même dû continuer de décrire l’HCQ comme un remède potentiel sous prétexte qu’elle n’aurait pas encore été étudiée chez un sous-groupe très précis, soit les gens faiblement malades qui ne passent que par les soins ambulatoires, comme l’avait fait Dr Raoult. Même si cela était vrai sur le plan factuel, ce serait néanmoins un brin tiré par les cheveux : quand une molécule aussi testée que l’HCQ ne donne rien de la prévention jusqu’au traitement des cas graves, elle a peu de chance d’avoir un effet chez les cas bénins. Mais le fait est que c’est faux. Fin 2020, un essai clinique en bonne et due forme a administré de l’HCQ (avec ou sans azythromycine, comme Dr Raoult l’avait fait) à 456 patients ambulatoires dans les 24 heures suivant un test PCR positif, et ces patients n’ont pas guéri plus vite ou fait moins de complications que ceux qui n’ont reçu qu’un placebo.
Nous réitérons que nous sommes plus que favorables à faire un bilan critique de notre travail de ces deux dernières années. Encore faut-il le faire avec rigueur, en se fondant sur les faits et en gardant en tête le contexte inédit de cette crise pour laquelle rien ne nous préparait.


.jpg)