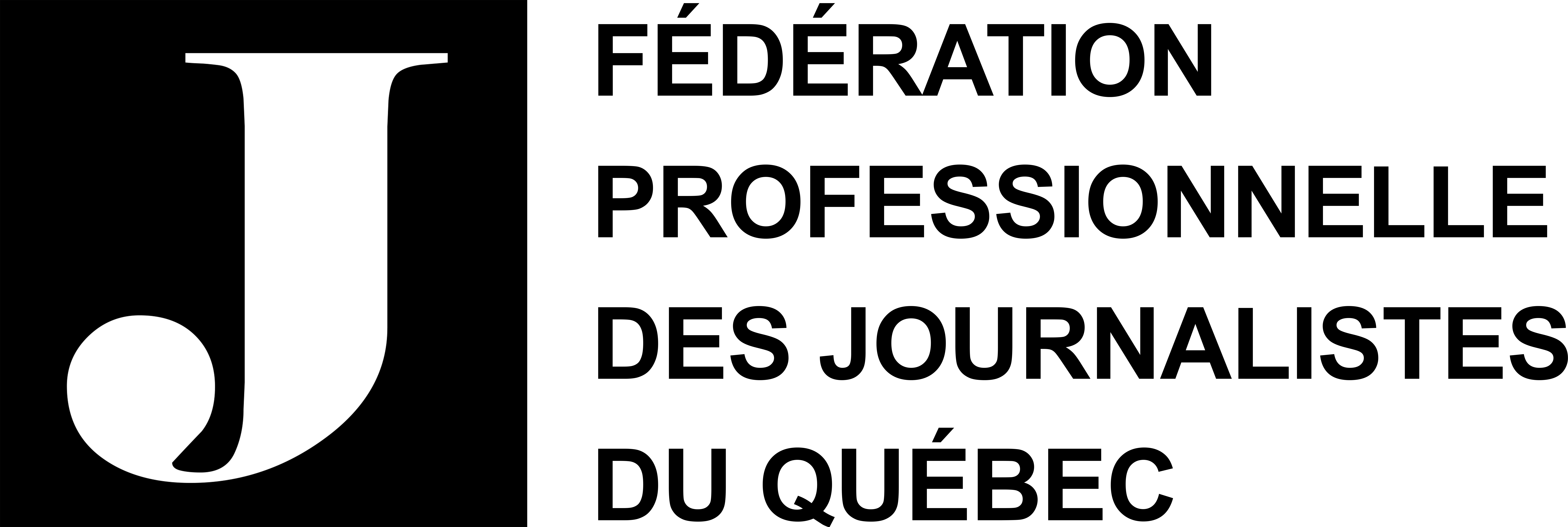Par Samuel Lamoureux
Candidat au doctorat en communication à l'UQAM et membre de la FPJQ
Enquête sur l’aliénation et la souffrance au travail des journalistes québécois
Voici un extrait de l'article, vous avez le texte intégral ici.
Le 5 décembre 2019, la Fédération professionnelle des journalistes du Québec (FPJQ) ouvre son infolettre hebdomadaire en annonçant la création d’un programme d’aide aux membres. Il s’agit d’un service de soutien (psychologique, juridique, financier, nutritionnel) confidentiel fourni aux journalistes, mais aussi aux membres de leur famille. Sous les mots soigneusement choisis du site Web tels que « résilience au travail », « relâcher la tension » ou « tenir la barre en période de changement » (FPJQ, 2020) se cache un phénomène très important de détresse psychologique chez les journalistes du Québec (Carine Henriquez, 2019).
La profession traverse une grande crise : le nombre de journalistes québécois a connu une baisse de 10 % entre 2006 et 2016 (1), en plus de subir une précarisation et une marginalisation croissance face aux industries des communications et des relations publiques (Giroux, 2019 ; Wilkinson et Winseck, 2019). Cette situation frappe particulièrement les pigistes qui ont vu leur revenu moyen diminuer de 30 % depuis 30 ans (AJIQ, 2019). C’est sans parler du Groupe Capitales Médias, représentant six journaux régionaux (2), qui a déclaré faillite en août 2019, avant d’être récupéré en coopérative (les retraités du groupe ont perdu 30 % de leur fonds de pension pendant le processus).
Les journalistes québécois n’ont pas besoin des chercheurs pour poser ce diagnostic. Ceux-ci sentent implicitement que la profession les menace. Dans un article du Trente, le magazine de la FPJQ publié également à la fin de l’année 2019, la journaliste pigiste Rose Carine Henriquez formule une critique sans appel de sa profession :
Les rédactions manquent d’argent ; les journalistes de temps. Nous perdons nos collègues les uns après les autres, l’information de qualité a de plus en plus de mal à tenir la route face aux fausses nouvelles. Les conditions de travail se détériorent et l’accélération est constante. Nous sommes plus isolés que nous le pensons. […] Nous sommes en train de nous aliéner (2019, p. 78).
À peu près au même moment, cette fois dans le Canada anglophone, la journaliste Anna Mehler Paperny publie un livre qui témoigne de ses dépressions et multiples tentatives de suicide : Hello I Want to Die Please Fix Me (2019). Celle-ci y relate ses aventures dans les institutions psychiatriques, hospitalières et policières, en plus de critiquer sa profession qu’elle qualifie de « menace constante » (mais aussi de « life-saver », j’y reviendrai) pesant sur elle (CanadaLand, 2020).
- S’il est connu que le journalisme de guerre, par exemple, peut causer des chocs post-traumatiques (...)
Comment faire sens de ces problèmes de santé mentale ? J’ai choisi pour le présent article de m’éloigner des études psychologisantes s’attardant aux symptômes (Reinardy, 2011) pour m’intéresser plutôt, dans une perspective qualitative, aux causes sociologiques, relationnelles et économico-politiques des problèmes de santé mentale des journalistes québécois, en accordant une attention particulière aux conditions de travail (3) et à la manière dont celles-ci sont vécues (Hesmondhalgh et Baker, 2011 ; Mosco, 2009).
- Parmi les travailleurs canadiens, 34 % se sentent stressés selon la Société pour les troubles de l’ (...)
La santé mentale est le bien-être psychique des individus. Elle est étroitement liée au pouvoir d’agir, à la capacité de « se servir de son expérience pour faire d’autres expériences » (Clot, 2017, p. 128). Pour la Commission de la santé mentale du Canada, la santé mentale peut se mesurer selon 25 indicateurs (ex. : taux de suicide, troubles anxieux) et plus précisément selon des facteurs comme le stress chronique ou le surmenage dans le cas du travail (CSMC, 2015). Grâce aux études en sociologie et en psychologie, nous savons que le travail est vécu de plus en plus comme une expérience de souffrance sous le néolibéralisme (Ehrenberg, 2010 ; Clot, 2017 ; Renault, 2006). Nous savons aussi que 10 % des Canadiens souffraient en 2019 de symptômes de maladies mentales, et plus particulièrement de stress dans le cas du travail (environ 30 % des travailleurs se sentent extrêmement stressés)4. Nous en savons toutefois peu sur les journalistes au Canada (seules des études américaines se sont penchées sur le sujet [Reinardy, 2011]). La présente étude souhaite faire un premier pas dans cette direction en adoptant une approche compréhensive influencée par la sociologie clinique qui s’intéresse au lien entre les faits sociaux et le vécu psychique des individus. L’approche clinique s’intéresse particulièrement à la souffrance, définie comme « un problème qui touche ou peine un sujet » (Blondel, 2007, p. 208) dans une optique d’émancipation. Dans cette perspective, le chercheur n’est pas neutre, mais participe à la création d’un « cadre qui favorise l’expression réflexive et émotionnelle pour la transformer en forces de réflexion et de coopération » (Gaulejac, Hanique et Roche, 2007, p. 23).
- J’utilise le terme de dialectique pour décrire la relation entre l’aliénation et la résonance dans (...)
Dans cet article, je prends également comme point de départ le fait que le travail journalistique est avant tout un travail créatif (Bouquillion, 2012) qui ne peut se comparer à un travail d’usine tel qu’analysé par la sociologie du travail classique. Les journalistes détiennent une autonomie relative (Hesmondhalgh et Baker, 2011) dans leurs procès de travail, ce qui leur permet de ne jamais être totalement vaincus par la domination du capital : ceux-ci aiment leur métier, écrire est une passion et chercher la vérité est un devoir civique qui donne sens à sa vie (Connery, 2011). Je me donne donc pour objectif de découvrir le rapport fondamentalement dialectique (5) entre l’aliénation des journalistes et la résonance que procure leur métier (Rosa, 2018), et plus particulièrement les manières d’opérationnaliser ces manifestations résonantes et aliénantes.
Ce texte sera divisé en quatre parties. Je reviendrai tout d’abord sur la littérature scientifique portant sur les conditions de travail et la santé mentale des journalistes. Avec l’aide du philosophe Hartmut Rosa, je déterminerai que les problèmes psychiques des travailleurs de l’information découlent d’un concept vieux de 150 ans : l’aliénation. Je présenterai ensuite les résultats de 10 entrevues semi-dirigées effectuées avec des journalistes sensibilisés aux questions de santé mentale et j’analyserai ces résultats dans une perspective relationnelle (qui met l’accent sur la relation au monde des individus [Rosa, 2018]).
Revue de littérature : la binarité entre critiques et libéraux
- Un art de gouverner développé depuis les années 1980 qui favorise entre autres la privatisation, la (...)
Les chercheurs en études médiatiques pensent historiquement les conditions de travail des journalistes de manière binaire (Cantillon et Baker, 2019). D’un côté, les auteurs critiques d’appartenances diverses vont souligner les multiples facteurs liés à la dégradation des conditions de travail des journalistes depuis la fin du XXE siècle et la montée du néolibéralisme (6). L’arrivée d’une économie qualifiée au début des années 2000 de postfordiste (on parlera plutôt de capitalisme de plateforme maintenant) (Boyer, 2004) encourage la flexibilisation des horaires et la précarisation des conditions de travail (Deuze, 2007). L’ubérisation de la société avantage avant tout l’accumulation du capital en abaissant les coûts de production (Cohen, 2015). Ce facteur, accompagné d’une nouvelle forme de management qui s’appuie sur des injonctions de flexibilité et d’autonomie (Renault, 2006), touche particulièrement les journalistes pigistes qui sont isolés et qui n’ont aucune protection organisationnelle ou sociale (Cohen, 2012 ; Accardo et al., 2007).
La concentration de la propriété des entreprises de presse, mouvement d’acquisitions et de fusions de grandes entreprises capitalistes, loin de favoriser un pluralisme de l’information, impose également une rationalisation délétère de la production médiatique (George, 2015 ; McChesney, 2008). L’un des meilleurs exemples de cette rationalisation est le phénomène de convergence (Goyette-Côté, Carbasse et George, 2012). Les journalistes sont appelés à produire des contenus adaptables sur le plus grand nombre possible de plateformes. En plus de produire plus avec moins de ressources, les reporters doivent constamment se mettre à jour (un travail non payé) pour suivre les tendances et entretenir leurs contacts sur les multiples réseaux sociaux (Cohen, 2015 ; Smyrnaios, 2013). Mark Deuze parle de workstyle pour décrire le fait que le travail journalistique ne s’arrête jamais ni ne connaît de temps mort. Dans ces conditions, la vie devient une façon de travailler (Deuze, 2007). C’est sans parler des nouvelles technologies qui, loin de simplement améliorer la qualité du travail, accélèrent également la production des nouvelles et leur circulation en temps réel (Fürst, 2020 ; Strauss, 2019 ; Estienne, 2013). La valeur marchande d’une information provient désormais de sa vitesse de circulation (Hope, 2010 ; Thompson, 2003).
Tous ces facteurs amènent les auteurs en psychologie sociale à affirmer dans leurs études que les journalistes souffrent plus qu’avant de surmenage professionnel (Reinardy, 2011). La profession est de plus en plus stressante, et les causes de ce stress peuvent être l’accumulation des échéances, les faibles revenus, la concurrence aussi bien que les longues heures de travail (Reinardy, 2011). Ces études démontrent également que les jeunes, surtout les jeunes femmes, sont particulièrement à risque de souffrir de surmenage et de quitter la profession (Reinardy, 2009 ; Macdonald et al., 2016). Cela peut s’expliquer par le fait que les cinq premières années sont souvent les plus difficiles (Pereira, 2020), compte tenu notamment de la précarité qui impose l’accumulation des projets et donc l’impossible conciliation travail-famille (MacDonald et al., 2016). D’autres études suggèrent que les reporters consomment plus que jamais de l’alcool et des drogues de performance (Aoki et al., 2012).
D’un autre côté, les auteurs libéraux encensent la période de « destruction créatrice » que connaissent les industries médiatiques, une telle période d’instabilité encourageant l’apparition de journalistes entrepreneurs (Briggs, 2011 ; Gillmor, 2004). La désinstitutionnalisation des médias favoriserait le développement d’une foule de start-up prêtes à innover (Kreiss et Brennen, 2016). L’esprit entrepreneurial pourrait permettre aux journalistes de reprendre le contrôle, individuellement et collectivement, de leur futur, en dehors des structures médiatiques hiérarchiques et rigides existantes (Carbasse, 2015).
Dans un récent texte (2018), Dan Gillmor explique par exemple comment tous les programmes universitaires de journalisme devraient initier les étudiants aux concepts de gestion et à l’esprit d’entreprise. Ceux-ci devraient aussi apprendre à coder et à forger des alliances avec des informaticiens, des graphistes, des programmeurs, etc. Les futurs journalistes ne devraient pas simplement connaître le modèle d’affaires des médias, mais plutôt adopter l’entrepreneuriat comme un style de vie :
Quand je parle d’« entrepreneuriat », je ne parle pas seulement du style de développement commercial de la Silicon Valley, où l’objectif est généralement une hypercroissance avec un coût marginal hyper réduit. Je parle aussi de ce que les investisseurs en technologie décrient comme des « activités assurant un style de vie » (lifestyle businesses), ce type d’entreprise pouvant soutenir quelques personnes, voire quelques dizaines, de manière durable (Gillmor, 2018, p. 28).
Ainsi, selon Gillmor, ce n’est pas une dizaine de grandes entreprises qui feront perdurer le journalisme, mais bien des dizaines de milliers de petites entreprises flexibles et innovantes. Être journaliste n’est pas une simple façon de gagner sa vie, ça doit devenir une identité, une manière d’exister (Deuze et Prenger, 2019). Cette façon de penser illustre bien ce qu’André Gorz appelait au début des années 2000 la « production de soi » (Gorz, 2003 ; Dardot et Laval, 2010). Dans un contexte de fragmentation du travail, les individus doivent s’assurer eux-mêmes de maintenir à jour leur qualification, leur santé et leur mobilité, bref leur employabilité (Gorz, 2017 ; Ehrenberg, 2010 ; Boltanski et Chiapello, 1999). Ainsi, le temps libéré par la réduction du temps de travail, loin de servir à l’organisation collective, doit plutôt être investi dans la (re)constitution du capital de compétence de chacun (Gorz, 2017).
Mais au-delà des approches critiques et libérales qui considèrent le travail journalistique soit comme un enfer précarisant, soit comme un paradis d’innovation, il est sans doute possible, et c’est mon hypothèse, d’adopter une position relationnelle entre les deux qui prendrait réellement compte de la subtilité du travail au sein des industries créatives au XXIe siècle. Comme l’écrivent Zelmarie Cantillon et Sarah Baker, « [c]reative labour cannot be described in binarized ways, as simply offering either pleasure or pressure, freedom or exploitation » (2019, p. 293).
- Gill utilise l’expression « industrie créative » dans le sens que les facteurs affectant les condit (...)
Dans une très bonne description des paradoxes du travail créatif, Rosalind Gill (2010) parle par exemple des 10 facteurs définissant le travail au sein des industries créatives7 :
-
L’amour. Les travailleurs sont attachés à ce qu’ils font ;
-
L’entrepreneuriat. Il y a une pression à innover, à entretenir son portfolio et à trouver de nouvelles idées ;
-
Précarité. Les travailleurs voguent de contrat en contrat sans stabilité ;
-
Faible revenu. Il y a beaucoup de compétition pour les emplois créatifs, ce qui pousse la rémunération vers le bas ;
-
De longues heures. Le travail ne s’arrête jamais et, à certains égards, doit même devenir un jeu ;
-
« Keeping up ». Il faut rester à l’affût des tendances et se mettre à jour ;
-
« DIY learning ». Il faut se former soi-même ;
-
Informalité. L’importance d’entretenir un réseau pour trouver du travail, des sujets et des sources ;
-
Exclusion et inégalité. Des facteurs comme la race et le genre bloquent certaines possibilités ;
-
Pas d’avenir. Les travailleurs créatifs sont tellement engagés dans le présent qu’ils n’ont aucune idée de ce qu’ils feront dans le futur.
D’autres études illustrent très bien cette ambivalence du travail créatif et journalistique (Mathisen, 2017 ; Morini, Carls et Armano, 2014 ; Hesmondhalgh et Baker, 2011).
Face à ces contradictions, mon objectif est de trouver un cadre théorique qui permet d’expliquer comment des travailleurs peuvent à la fois aimer leur travail et se sentir menacés par celui-ci. L’approche relationnelle de Rosa, qui combine l’aliénation et la résonance, est la solution que j’adopterai.
MéthodologieLa démarche méthodologique s’est déroulée en deux temps. J’ai tout d’abord effectué une revue de la littérature sur les liens entre journalisme, aliénation et santé mentale. Ce travail m’a permis de découvrir que les études se limitaient beaucoup à la psychologie (Reinardy, 2011) et abordaient peu les autres sciences sociales. Or, comme le dit Mike Healy (2020), les études en psychologie du travail s’adressent surtout aux gestionnaires des entreprises qui sont appelés à remodeler les conditions de travail, au contraire des études critiques qui mettent plutôt l’accent sur l’auto-organisation des travailleurs et des travailleuses. Il m’est donc apparu clair que ma recherche devait s’inscrire dans une perspective émancipatrice qui s’attarde avant tout aux causes de la souffrance et aux moyens de les changer, ce que les marxistes autonomistes nomment une démarche de corecherche (Leonardi, Armano et Murgia, 2020). J’ai par la suite cherché et parcouru les livres les plus pertinents écrits par des journalistes sur la question de la santé mentale pour m’approcher du point de vue plus situé des journalistes (une liste de ces neuf livres se trouve en annexe). C’est en lisant le livre Hello I Want to Die Please Fix Me (2019), dans lequel la journaliste Anna Mehler Paperny qualifie son travail à la fois de life-saver (qui donne un sens à sa vie) et de constant threat (qui la menace constamment), que j’ai découvert pour la première fois le lien entre aliénation et résonance dans le travail journalistique.
J’ai ensuite réalisé des entrevues semi-dirigées avec dix journalistes québécois. L’entrevue semi-dirigée est définie comme une conversation souple où le chercheur ne pose que des questions ouvertes et se laisse guider par les réponses de son interlocuteur (Savoie-Zajc, 2009). Mon objectif était de parler à des journalistes qui avaient déjà pris la parole dans l’espace public sur le sujet de la santé mentale. Mon échantillon était donc très petit : je ne voulais pas contacter des journalistes ayant souffert de surmenage professionnel, mais plutôt des journalistes ayant pris la parole dans l’espace public sur les questions de santé mentale (soit dans des articles, des entrevues, des prises de parole publiques, etc.). Cette démarche favorisait l’empowerment des participants et évitait de mobiliser des personnes encore traumatisées par leurs expériences.
L’échantillon est aussi petit car le sujet est historiquement tabou : ce n’est que lors de son congrès de l’automne 2019 que la FPJQ a organisé pour la première fois une table ronde sur le thème de la santé mentale. J’ai donc contacté les organisateurs de cette activité (leurs noms ne sont pas publics) pour ensuite appliqué la méthode boule de neige (Babbie, 2007) pour me laisser guider vers d’autres journalistes ayant pris la parole sur le sujet. Cela m’a amené à parler à des journalistes pigistes, mais aussi à des journalistes travaillant dans des quotidiens, des magazines ou à la télé et à la radio ainsi qu’à un rédacteur en chef et à un gestionnaire (deux hommes et huit femmes au total). À la manière de Nicole Cohen (2019), les entretiens ont duré environ une heure et ont porté sur le travail et les tâches des journalistes, sur les technologies et les outils qu’ils utilisent, sur leurs sentiments à l’égard de leur profession (ce qui est le plus frustrant, ce qu’ils aiment le plus), sur la séparation entre loisir et travail ainsi que sur les conditions matérielles et leurs situations professionnelles. Les entretiens ont été enregistrés, transcrits et codés selon les thèmes qui ont émergé de ces entretiens. Les noms ont été anonymisés et remplacés par des codes alphanumériques (de J1 À J10).
Cette recherche a été approuvée par un certificat éthique du CERPE de l’Université du Québec à Montréal pour la recherche qui concerne les êtres humains. Considérant que quatre interviewés avaient souffert de surmenage professionnel dans les deux dernières années, le principal risque éthique était que ces personnes se remémorent leurs expériences traumatiques pendant l’entrevue. Le danger pour le chercheur est d’instrumentaliser le vécu des personnes vulnérables pour le bien de sa recherche en laissant pour compte le bien-être de celles-ci (Caldairou-Bessette et al., 2017). Mais ce n’est pas parce que des personnes sont vulnérables que la recherche doit les délaisser. Au contraire, ces personnes sont justement mises de côté par les institutions (ou enfermées par celles-ci), et il est donc d’autant plus important de comprendre leur vécu afin de répondre à leur besoin. Cela veut dire que le chercheur doit faire preuve d’une réserve nécessaire dans l’évocation des contenus potentiellement traumatiques (Gaulejac et Laroche, 2020). L’entretien doit s’articuler autour des circonstances de vie actuelles et des soins reçus. Le chercheur doit aussi faire preuve d’empathie (il se rend disponible et accueille le discours de l’autre) et assurer un suivi auprès de ses « sujets de recherche ». De prime abord, la recherche n’a pas de visée thérapeutique, mais elle peut avoir des effets thérapeutiques, car elle permet de fabriquer du sens (Gaulejac et Laroche, 2020). Elle peut permettre un retour réflexif qui mène à un changement de vie. L’enjeu est de faire en sorte que l’expérience de recherche soit une expérience d’empowerment qui serve à créer un processus de réflexion potentiellement bénéfique pour sa situation.
Présentation des résultats
Ce qui résonne
Commençons par le début. Pourquoi les journalistes ont-ils choisi d’exercer ce métier ? Qu’est-ce qui les attire vers cette profession ? Quelle passion les retient encore de vouloir complètement se détacher de cet environnement qui en a poussé plusieurs vers le surmenage ? Les journalistes interviewés croient d’abord en l’éducation populaire et en l’idéal de l’information. Le journalisme est encore aujourd’hui lié à un idéal normatif fort (le quatrième pouvoir de la démocratie) qui est transmis entre autres par la culture populaire et les programmes universitaires. Ce qui motive avant tout six journalistes, c’est de chercher la vérité avec un grand V :
Pour moi l’information est réellement le quatrième pouvoir, cette espèce de pouvoir ultime de la démocratie, pour moi c’est une espèce de rempart face aux autres pouvoirs : pouvoir économique, pouvoir politique, pouvoir judiciaire. Il y a cette espèce de vertu-là qui est forte en moi, et c’est pour ça que j’ai commencé à faire ça. Pour moi y’avait une espèce d’appel à ok ben c’est tellement important pour la société que ça soit là, ç’a toujours été ça mon moteur (J1).
On veut bien informer le public. Ce n’est pas juste important, c’est absolument nécessaire, c’est primordial, c’est au cœur de la démocratie (J6).
Travaillant dans l’information culturelle, deux journalistes sont avant tout passionnés par le fait d’aller à la rencontre des artistes et de rapporter la manière dont ceux-ci voient le monde. Être en contact avec des artistes et vulgariser leurs visions est pour eux un privilège. Travaillant pour un média alternatif, un journaliste rajoute le fait de donner la parole aux sans-voix :
Le contact avec les gens, ça j’ai toujours aimé ça. Et être la porte-voix d’une vision, même si elle est imparfaite, mais d’une vision qui amènera toujours du débat à notre société, qui pourra toujours l’enrichir d’une quelconque manière (J2).
J’aime vraiment cette idée-là d’avoir l’impression d’être un peu une espèce de courroie de transmission entre apprendre quelque chose qui m’intéresse, les artistes et le public (J4).
Trouver des histoires originales, de donner aussi la parole aux gens qu’on n’entend pas ou qu’on entend moins. […] Il y a plein de gens anonymes, des gens marginalisés qui méritent qu’on leur donne la parole et qui méritent qu’on parle de leurs luttes, de leurs droits (J5).
Quand je demande à mes interviewés comment se manifeste concrètement cette flamme de la passion au jour le jour, leur réponse est plus nuancée. Ceux-ci ne travaillent pas sur des sujets passionnants qui vont changer le monde tous les jours. Ils ne rencontrent pas des personnes passionnantes à chaque entrevue non plus. Mais régulièrement une nouvelle histoire ou une rencontre particulière émerge et rappelle aux journalistes le but fondamental du métier. Cinq d’entre eux disent qu’ils aiment « apprendre tous les jours » :
Quand j’allais dénicher une histoire à laquelle je croyais, et que je rencontrais ces personnes-là qui acceptaient d’ouvrir leur intimité, leur espace, avec beaucoup de générosité. À chaque fois que je rencontre un artiste, et qu’on parle pendant des heures de son processus de création. C’est à cause de toutes ces raisons que je continue encore un peu (J2).
J’apprends tout le temps des choses […]. Je me sens privilégié chaque fois que je parle à des gens intéressants, je rentre dans leur réalité (J7).
Plus que dans les histoires ou les entrevues, la passion vient aussi du contact avec son public ou sa communauté :
Quand les gens m’écrivent pour me dire que [mon article] ça les aide à mieux se comprendre, ça les aide à affronter des trucs dans leur vie, et bien, c’est sûr que ça, ça vient comme animer cette flamme-là. Bon ben voilà, on a un impact dans notre communauté (J1).
Je me sentais vraiment privilégié de pouvoir avoir ces conversations-là avec des gens passionnants, de savoir que ça allait se rendre à un public plus large, là je trouve que je suis à la bonne place (J4).
Voici donc un récapitulatif des facteurs qui « résonnent » dans le travail journalistique. Il y a tout d’abord l’idéal du métier, celui de chercher la vérité et de surveiller les gouvernants. Les recherches en sociologie du journalisme analysent depuis longtemps le grand attachement des reporters à leur métier (Pilmis, 2010 ; Russo, 1998). Mais cet idéal n’est pas qu’une idéologie, ce n’est pas qu’un récit mythique, il se matérialise réellement dans un métier qui captive, qui passionne, qui donne la chance aux journalistes de travailler presque tous les jours sur de nouveaux sujets qui leur permettent d’en apprendre plus sur le monde qui les entoure (Wahl-Jorgensen, 2019). « Il y a toujours un moment dans l’année où oui on tombe sur une espèce de dossier qui vient comme réanimer ou réalimenter cette flamme-là » (J1).
De plus, contrairement aux ouvriers décrits par Marx, les journalistes ont bien souvent une autonomie relative au point de conception-idéation du procès de travail (Cohen, 2012). Cela veut dire que ceux-ci doivent produire, mais que cette production peut être unique, créative et surtout porter leur nom. Les produits du travail (articles, reportages) produisent donc une fierté ou un attachement qui vient en principe enrayer l’aliénation classique face au produit du travail (Hesmondhalgh et Baker, 2011). Comme le dit Rosa, « l’exercice d’une activité fait notre joie et notre bonheur lorsqu’elle porte en elle-même la fin qui la détermine » (2018, p. 14). Régulièrement, des projets ou des idées viennent motiver les journalistes et les reconnectent avec leur idéal : « Quand un journaliste me pitch de quoi et je me dis ayoye c’est bon et je sens que ça peut faire changer les choses, parce que moi c’était ça l’idée aussi d’être journaliste, c’était d’influencer ma société en dénonçant les inégalités » (J5).
De plus, la résonance vient aussi des relations établies à la fois avec les collègues, les sources et le public. On trouve ici les relations résonantes horizontales, cette idée de communauté qui est si importante pour six journalistes interrogés. Pour Clot, la santé au travail passe par le pouvoir d’agir, par la constitution d’un travail collectif qui a « besoin d’un collectif de travail dont l’histoire traverse chacun » (2017, p. 69). « Dans la salle, tout le monde se connaît et on essaie de se soigner » (J8). Le journalisme représente bien cette passion affective (Wahl-Jorgensen, 2019), bien que celle-ci soit de plus en plus remise en question par ses contraires. C’est ce que nous verrons dans la prochaine partie (Morini, Carls et Armano, 2014).
Ce qui résonne :
-
L’idéal journalistique de travailler pour le bien commun, de chercher la vérité, l’attachement au métier ;
-
L’autonomie relative dans la poursuite de ce travail/dans la manière de le réaliser ;
-
Les relations avec les collègues et les sources ;
-
Le contact avec le public et le fait d’avoir une influence dans sa communauté.
Aliénation et souffrance au travail
La passion ne vient jamais seule. Dans les entretiens, elle est régulièrement présente avec son contraire. Quatre journalistes parlent d’une relation « amour-haine » avec leur métier. Un interviewé me dit que les journalistes ont tendance à se « sacrifier au nom de l’information », ou encore que la passion vient « invisibiliser des trucs » (J1) qu’ils n’accepteraient pas ailleurs. Le métier est « malsain », précisent deux reporters.
La flamme de la passion vacille régulièrement, le déclin ultime de cette flamme étant l’épuisement professionnel et le surmenage vécus par quatre journalistes ou encore la transition vers d’autres métiers plus soutenables, comme c’est le cas de deux autres reporters (bien que ceux-ci soient revenus vers le journalisme depuis). Quelles sont les causes du déclin de la santé mentale de mes interviewés ? Pour deux journalistes, le tout commence avec les vagues de compressions à Radio-Canada sous le gouvernement conservateur de Stephen Harper (2006-2015). Tous deux ont été licenciés lors de ces compressions. « On coupe on coupe et on est appelé à faire plus avec toujours moins » (J5). Sept journalistes sont d’avis que la crise du modèle d’affaires des médias, combinée à un contexte d’austérité budgétaire, fragilise la stabilité financière et les conditions de travail des journalistes :
C’est sûr qu’il y a la multiplication des tâches. Avant tu arrivais et tu faisais ton article pour le lendemain et c’était ça, aujourd’hui faut que t’envoies un breaking news, faut idéalement que tu alimentes toutes les plateformes, tu fais des petites affaires sur Twitter ici et là pour teaser le lecteur. Il y a beaucoup d’ajouts qui se sont fait dans nos tâches au quotidien sans que la journée se soit nécessairement allongée en conséquence. Alors des fois on a l’impression de faire plus mais de faire moins bien. Ça induit beaucoup de stress (J6).
Crime ça fait au moins quinze ans que dans tous les médias y’a des coupures, y’a des compressions, on demande aux journalistes d’en faire plus, mais pas nécessairement avec plus, en fait c’est souvent avec le même nombre d’heures. […] Donc c’est sûr que ça, cette accumulation de tâches, de devoir toujours en produire plus, et cette espèce de, ben il n’y a pas de revenu donc à moment donné oui il faut que la nouvelle vende, il faut que la nouvelle fasse des clics, et bien tout ça ça met de la pression. Moi je pense que tout ça n’aide pas déjà, à la santé mentale des journalistes (J1).
Cinq journalistes pointent également du doigt la précarité financière. Ils travaillent de longues heures et sont payés des « peanuts » (J7). Ceux qui sont passés par le statut de pigiste ajoutent aussi à la liste la solitude et le manque de respect des rédacteurs en chef. Certains gestionnaires imposent encore des « régimes de terreur » (J9), bien que la situation change avec le temps. Deux journalistes déplorent également le fait que certains médias proposent de payer en « visibilité » et non en salaire :
La solitude aussi. Beaucoup de solitude. Eh, et la précarité financière. C’est quand même tough (J2).
Je me mettais à travailler vraiment vraiment vraiment beaucoup et étant donné que moi souvent je suis plus payé au forfait qu’à l’heure, eh bien ça n’arrêtait juste jamais (J4).
Les surnuméraires qui n’ont pas d’heures garanties […] c’est dur de prévoir une vie sociale, c’est dur de prévoir ses finances, c’est dur, ça vient tout, ça freine tout enfin. Donc là ça ajoute une autre pression en plus de celle justement de devoir produire plus (J1).
Au-delà de la précarité financière, quatre journalistes se sentent aussi mal parce qu’ils sont traités comme des objets. Un journaliste dit qu’il se sent comme « un robot à la chaîne » (J2). Un autre ajoute que des journalistes deviennent « blasés » à force de couvrir des sujets insignifiants qui ont peu d’influence dans leur communauté (J5). Ceux-ci deviennent « désillusionnés ». C’est particulièrement vrai pour les reporters qui travaillent en ville pour des gros médias. Il est facile de se sentir insignifiant dans ces « grosses machines » :
Certains empires médiatiques comme par exemple Québecor ou Radio-Canada je veux dire il y a plein de jeunes que leur rêve c’est d’y rentrer et de faire des grandes choses mais pour les trois-quatre vedettes qu’on voit y’en a des centaines qui sont dans l’ombre et qui mettent des choses en ligne pendant cinq ans avant de faire un reportage (J5).
- Il est intéressant qu’un journaliste utilise ici le mot interchangeable, considérant que celui-ci r (...)
On se sent comme des bêtes, c’est peut-être un mot fort… On est interchangeable9 en fait. Parce qu’on a toujours peur de gueuler trop fort parce qu’on se dit ouais des pigistes y’en a, y’en a qui se cherchent de la job donc… Une rédaction qui n’a pas intérêt à garder les pigistes turbulents, ben elle va dire je vais commander à un autre (J2).
Quant à l’effet des nouvelles technologies sur les conditions de travail, tous les journalistes répondent que celles-ci sont à la fois aidantes et aliénantes. Les nouvelles technologies comme Internet ou les téléphones intelligents ont stimulé la production journalistique et facilité l’accès aux archives maintenant numériques. Mais elles ont surtout accéléré et intensifié le rythme de production. Les réseaux sociaux ont aussi augmenté les commentaires haineux, disent trois journalistes :
La vitesse à laquelle les choses vont, il n’y a personne qui est capable d’aller à cette vitesse-là, donc on a tout le temps l’impression qu’on est en rattrapage (J8).
Faut être le premier sur la nouvelle, faut toujours sortir plus vite que l’autre, donc là avec les chaînes d’info en continu aussi ça fait augmenter la pression, faut meubler faut meubler faut trouver, faut comme nourrir la machine à saucisses (J5).
Ça a tout le temps été rapide, mais là, avec Twitter et les réseaux sociaux c’est un rythme assez infernal (J3).
Les nouvelles technologies sont surtout des outils qui rappellent l’existence du travail et des tâches à accomplir, particulièrement dans la sphère privée (Deuze, 2007). À ce sujet, tous les journalistes décrivent la très grande difficulté qu’ils ont à séparer la sphère du travail de la sphère du loisir. Il faut toujours être disponible, « toujours dire oui » (J7). Deux journalistes mentionnent aussi l’impossible conciliation travail-famille :
Le droit à la déconnexion en journalisme ça n’existe pas. T’as des intervenants qui se permettent de t’écrire au milieu de la nuit parce qu’ils veulent revenir sur un truc qu’ils ont dit. Je trouve que ta vie privée en prend beaucoup (J2).
Quand je lis un magazine, quand je suis sur mes réseaux sociaux quand j’écoute la télé, mon cerveau est tout le temps un peu en mode journaliste, en mode qu’est-ce qui ferait un bon article. C’est jamais à off (J3).
Tu as ton cellulaire, tu as les textos, tu as une alerte sur Facebook, tu as une alerte courriel, tu décroches juste jamais en fait. Pi ça c’est dangereux pi moi je sais que ça a contribué à mon burnout justement, que je n’arrivais pas à décrocher. Ma journée ne se finissait jamais (J1).
La connexion est une drogue. Ça rend « addict », disent quatre journalistes. Le journalisme est un métier intense, hyper stimulant, sous pression, qui procure de « l’adrénaline ». Il comble un vide et rend dépendant (Le Cam et Ruellan, 2017). Deux journalistes disent ceci au sujet de l’instant où ils ont quitté momentanément le métier :
J’ai ressenti un vide et en même temps j’ai ressenti un calme. Je ne sais pas j’avais l’impression de me retrouver après un long moment où j’étais comme en mode pilote automatique (J2).
Ça m’a juste fait prendre conscience à quel point je me suis poussé à bout pi à quel point je me suis laissé presser comme un citron (J4).
Les technologies ne sont pas l’apanage des travailleurs de l’information. Les rédacteurs en chef vont aussi s’en servir pour développer des outils de mesure d’attention du public (Fürst, 2020). Ces outils permettent de mesurer le temps de lecture, le profil des gens qui lisent, quels types de nouvelles, combien de temps, est-ce qu’ils lisent au complet, juste le titre, le premier paragraphe, etc. Selon un journaliste, cela participerait à la déshumanisation de son métier, dans le sens où les algorithmes semblent remplacer les lignes éditoriales :
Ils ont tellement de données et après ça bon finalement, c’est qui le rédacteur en chef, c’est les données ou c’est le rédacteur en chef ? Qui vient de décider ce qu’on faisait comme nouvelle finalement ? Et même là-dedans on pourrait rentrer Google. On s’ajuste toujours pour que nos articles justement sortent sur Google, parce que sinon ils passent dans le beurre. Ben ça c’est énorme comme influence (J1).
Le seul gestionnaire interviewé dans cette recherche se défend d’une telle position : « Ce n’est pas vrai qu’on pense juste aux profits. Oui on pense budget mais au final on veut faire les meilleurs choix pour le public et transmettre les valeurs de l’institution » (J9).
Comme le rappelle Renault dans un article sur l’actualisation du concept d’aliénation (2006), le capitalisme postfordiste se caractérise par de profondes transformations de l’organisation du travail : une entreprise dite « maigre » (mais au bout du compte plus concentrée que jamais), un management de la flexibilité et un rapport salarial où le salaire direct diminue aux dépens d’une précarisation et d’une dissolution des frontières de la journée de travail traditionnelle (Hardt et Negri, 2013 ; Harvey, 2014 ; Dejours, 2000). Toutes ces causes sont ici présentes : les journalistes ont effectivement l’impression d’effectuer à la fois un travail qui ne s’arrête jamais à cause de la non-séparation entre le travail et le loisir, mais aussi un travail qui s’intensifie et s’accélère constamment, notamment en raison de la présence des nombreux dispositifs algorithmiques qui rappellent toujours la prochaine tâche à faire à n’importe quelle heure du jour et de la nuit (Leonardi, Armano et Murgia, 2020). Suivant Rosa, on peut dire que les conditions de travail actuelles imposent des relations au monde « muette[s], froide[s], figée[s] ou en échec[s], […] le résultat d’une subjectivité dégradée » (2018, p. 23).
Un monde pris dans un processus d’accélération effréné et d’accroissement illimité [peut] entraver systématiquement la formation de ces rapports de résonance — par la destruction, notamment, des rythmes sociaux — et produire ainsi des relations muettes et aliénées (Rosa, 2018, p. 37).
Dans un livre précédent intitulé Aliénation et accélération (2014), Rosa traite de l’accélération des rythmes de vie qui produit une aliénation du sujet par rapport à l’espace, aux choses, aux actions, etc. Ces facteurs sont tous présents. Un journaliste (J2) m’indique qu’il aimerait sortir sur le terrain, mais que son horaire le contraint à rester chez lui constamment, la grande majorité de ses entrevues se faisant maintenant par téléphone (aliénation dans l’espace). Un autre m’explique (J6) qu’il se réveille dans la nuit pour vérifier les alertes de son téléphone, il le regarde la fin de semaine et pendant ses vacances pour vérifier le retour de l’intervenant ou l’assignation du patron (aliénation aux objets).
Plusieurs journalistes m’ont aussi fait part de la frustration de ne pouvoir travailler sur les sujets qui les font vibrer, ceux-ci devant remplir des commandes qui paient davantage comme de l’écriture promotionnelle — l’aliénation à nos actions, le fait « de ne jamais trouver le temps de faire ce dont nous avons envie » et de ne s’impliquer « que dans des activités qui mènent à une rapide satisfaction et qui répondent à de “faux besoins” » (Weber, 2014, p. 92). On pourrait rajouter l’aliénation par rapport au temps, où le fait que nos journées soient fragmentées en de multiples tâches dépourvues de liens (Rosa, 2014). « Le sentiment de satisfaction, qui est hyper important dans n’importe quel emploi, n’est pas là. Parce qu’on a tout le temps l’impression qu’on fait les choses à moitié » (J8). La passion présente dans la première partie de l’analyse est donc constamment rongée.
Ce qui aliène :
-
La précarité, de longues heures pour moins de revenus, plus de rémunération symbolique ;
-
L’intensification du travail, la surcharge, le sentiment d’être débordé ;
-
la rationalité algorithmique, la dépossession du pouvoir d’agir par algorithmes ;
-
La connexion permanente ;
-
La réification, le rapport avec certains gestionnaires qui imposent des « régimes de terreur » ;
-
Le travail qui ne s’arrête jamais, l’absence de séparation entre travail et loisir ;
-
Pour les pigistes, l’isolement et la concurrence méritocratique.
Discussion : changer notre relation au monde, forger des axes de résonance
J’analyserai finalement dans la dernière partie les liens entre les éléments résonants et les éléments aliénants identifiés dans le procès de travail journalistique en rapport avec la littérature scientifique. S’agit-il, comme le proposent parfois les perspectives critiques, d’une colonisation des logiques capitalistes sur l’idéal du métier (McChesney, 2008) ? Ou encore de la place toujours grandissante des logiques marchandes par rapport aux dimensions promues par le discours professionnel, ce qui crée une forme de décalage, comme le dit Luc Boltanski (2009), un choc entre l’officiel et l’officieux, entre le matériel et le symbolique, entre le travail prescrit et le travail réel (Dejours, 2000) ? Dans le cas du journalisme, on peut penser au choc entre les valeurs éthiques idéalistes apprises à l’université (impartialité, équité, exactitude) et les conditions parfois brutales du monde du travail. Dans cette conception, il faudrait parler d’une histoire de déclin entre l’idéal (qui résonne) et la réalité (qui aliène).
Mais cette colonisation par l’aliénation représente mal la relation dynamique présente entre l’aliénation et la résonance. Pour Rosa, la résonance n’existe pas sans l’aliénation. La résonance est momentanément possible parce que le monde, défini comme tout ce qui vient à notre rencontre, est indisponible, inappropriable, parce qu’il nous est presque toujours aliéné. « La résonance a constitutivement besoin de son envers — que nous avons précédemment défini comme ce qui est étranger ou aliéné » (2018, p. 213), elle est « l’éclair d’un espoir d’assimilation et de réponse dans un monde qui se tait » (ibid., p. 215). La résonance n’a rien à voir avec l’harmonie, à sa racine, il y a « le cri du non-réconcilié et la souffrance de l’aliéné. […] Ainsi, la capacité de résonance et la sensibilité à l’aliénation s’engendrent et se renforcent mutuellement » (id.). Le lien entre aliénation et résonance, comme le montrent les extraits ci-dessous, est cyclique :
Dans mes dernières années j’avais mes espèces de up and down où j’avais ces moments-là où mon dieu j’étais tellement stimulé par le métier, que ça soit justement par des histoires, par des sujets, par des rencontres, pi après ça oh mon dieu je me sentais après complètement ramassé par mon métier, pi ces up and down-là ont contribué à mon burnout (J1).
Chaque fois c’est comme si je passe tout le temps par une espèce de cycle en fait où est-ce que je propose un sujet, il est accepté, j’suis vraiment contente, je commence à le travailler, pi là je me sens envahie par tous les autres éléments qui gravitent autour de ça et nécessairement je passe par un ok est-ce que ça vaut la peine que je fasse ça ok est-ce que je devrais juste me trouver une autre job (J5).
L’idéal n’est donc pas colonisé ou neutralisé par les logiques marchandes, ou du moins cette conception est trop statique, elle ne rend pas compte que l’idéal entretient une relation dynamique avec son contraire et qu’il peut refaire surface régulièrement. Rappelons-nous les interviewés qui indiquent que plusieurs fois par année un sujet ou une entrevue vient raviver leur « flamme ». La passion et son déclin coexistent de manière cyclique. Et ce cycle entre la résonance et l’aliénation, et c’est précisément l’angle mort des recherches critiques qui ne parlent que de colonisation marchande, est vécu de manière très rapide. Il est parfaitement possible de commencer sa semaine avec une idée résonante et de la finir aliéné par les surcharges et la rationalité algorithmique des gestionnaires. Un journaliste me dit qu’il se sent chaque semaine « comme un yo-yo » (J8). Les moments euphoriques laissent la place très rapidement à des moments déprimants, et vice-versa. Et c’est précisément ce cycle qui est dur pour la santé mentale : il crée de l’instabilité psychique où le travailleur vogue très rapidement entre des états contraires, des états aliénants et résonants, déprimants et passionnants, méritocratisants et précarisants (Mathisen, 2017).


.jpg)